Rechercher : tempête blanche
19, River Street, de Laure Rollier
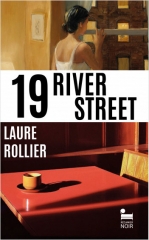 Un écrivain à succès, Gabriel, doit rédiger son prochain roman. Il décide de s’installer chez une psychologue, Maddie car elle loue le premier étage de sa maison. On découvre rapidement que c’est une femme traumatisée par la disparition de sa fille une dizaine d’années auparavant alors qu’elle était avec son mari (dont elle est séparée depuis) et leur second enfant : un garçon, Marcus, qu’elle ne rencontre pas souvent.
Un écrivain à succès, Gabriel, doit rédiger son prochain roman. Il décide de s’installer chez une psychologue, Maddie car elle loue le premier étage de sa maison. On découvre rapidement que c’est une femme traumatisée par la disparition de sa fille une dizaine d’années auparavant alors qu’elle était avec son mari (dont elle est séparée depuis) et leur second enfant : un garçon, Marcus, qu’elle ne rencontre pas souvent.
Le corps de la fillette n’ayant jamais été retrouvée, sa mère continue d’espérer en se disant que peut-être…
Un jour, elle trouve sur le pare-brise de sa voiture un message lui donnant rendez-vous et précisant que Josephine est en vie. N’importe quelle mère réagirait comme elle. Quand il y a un mince, même minuscule espoir, on s’accroche.
Donner suite ou pas à cette proposition de rencontre ? Prendre le risque de souffrir une nouvelle fois, d’être déçue ? Passer à côté, peut-être, d’une excellente nouvelle ? Se rendre sur place seule ou accompagnée et si c’est le cas, avec qui ? Son ex époux ? Son fils ? Y-a-t-il des bons et des mauvais choix ?
Dans ce très bon thriller psychologique, Laure Rollier a su me surprendre. Chaque personnage a sa part d’ombre, de secrets inavoués. Ils essaient souvent d’agir dans un but très précis, pas forcément de manipuler mais de maîtriser les événements sauf que ce n’est jamais comme ça. Tout le monde le sait, certains faits nous échappent, le hasard, le destin ou un grain de sable interviennent et rien n’est comme prévu.
C’est un roman choral où s’expriment principalement Maddie et Gabriel, puis Marcus. Parfois, leurs points de vue sur une même situation sont présentés. Mais le plus souvent, on suit leur quotidien, leurs échanges entre eux ou avec d’autres. On apprend à les connaître. Au fil des pages, on aperçoit leur passé. On observe leurs réactions en cherchant à les comprendre. Gabriel est intéressant dans son trouble face à la page blanche, obligé d’être aussi bon écrivain que pour son premier titre. Pourquoi a-t-il choisi de s’installer chez Maddie ? Y-a-t-il une raison précise ou pas ? Qu’est-ce qui bloque son écriture ? A-t-il des problèmes ou est-il simplement en manque d’inspiration ?
Au fur et à mesure, des informations supplémentaires sont apportées, nous offrant plusieurs pistes. On fait des hypothèses et puis un autre élément nous fait douter et on revoit nos déductions. Ce qui est sûr et certain que jamais je n’avais imaginé ce qu’il en était réellement. Chapeau bas à Laure Rollier, elle a fait très fort ! On ne voit rien venir, elle nous retourne comme une crêpe et hop, on reste figé, la bouche ouverte, totalement scotché par son imagination !
Les chapitres courts, l’écriture fluide, le style vif, les dialogues ciblés et le rythme rapide font de ce récit un texte addictif, prenant, enthousiasmant par l’approche psychologique réfléchie et parfaitement dosée.
J’ai été rapidement embarquée dans cette histoire, je voulais avoir les tenants et les aboutissants, cerner ce que certains taisaient et pour quelles raisons et j’ai tourné les pages jusqu’à un final étourdissant de maîtrise !
Éditions : Récamier (8 Février 2024)
ISBN : 9782385770914
274 pages
Quatrième de couverture
« Je sais ce qu’il s’est passé sur La Dernière danse. Josephine est en vie. Demain, 22 heures. Venez seule. » Ces simples mots, notés sur un bout de papier, confirment ce que Maddie a toujours su : sa fille est vivante, quelque part. Ce mot laissé devant chez elle représente alors un ultime espoir. Prête à tout pour retrouver son enfant, Maddie sollicite l'aide de Gabriel, un jeune écrivain en quête de tranquillité, à qui elle vient de louer l’étage de sa maison.
11/02/2024 | Lien permanent
Bigoudis et petites enquêtes - Tome 5 : Panique au festival du livre, de Naëlle Charles
 Cinquième aventure de ma coiffeuse préférée ! Retrouver Léopoldine Courtecuisse, c’est comme retrouver une bonne copine. On galère ensemble, on s’énerve, on rit, on râle, on s’écoute….
Cinquième aventure de ma coiffeuse préférée ! Retrouver Léopoldine Courtecuisse, c’est comme retrouver une bonne copine. On galère ensemble, on s’énerve, on rit, on râle, on s’écoute….
C’est une histoire indépendante mais il est plus intéressant de lire dans l’ordre pour voir l’évolution des personnages et de leurs relations. Si toutefois, vous commencez par ce tome, pas de panique. Dans les premières pages, les principaux protagonistes sont présentés, avec les informations à connaître sur eux.
Pour ceux et celles qui auraient oublié et qui débuteraient par ce livre, l’essentiel à savoir c’est que Léopoldine (Léo) vit seule avec ses deux adolescents (son mari l’a quittée pour s’installer avec sa sœur). Elle a aidé plusieurs fois le lieutenant Quentin Delval pour résoudre des enquêtes. Comme elle a un salon de coiffure avec sa meilleure amie, elle entend beaucoup de choses. En plus, elle est futée et a un excellent esprit d’observation et de déduction.
Cette fois-ci, sa mère a décidé d’organiser un salon du livre avec des auteurs connus, des animations, des conférences. Le temps presse et toute la famille est mobilisée. Le comité d’organisation se réunit régulièrement et des tensions commencent à exister. Ah les égos féminins ! Constance, la jeune sœur de Léo se « branche » avec une personne du groupe qui, quelque temps plus tard, est retrouvée morte. Bien entendu, Constance est placée en garde à vue. Il va falloir prouver qu’elle n’est pas coupable. Mais Quentin, trop proche de la famille Courtecuisse est dessaisi de l’affaire au profit de la police dont l’équipe vient s’installer dans sa gendarmerie, prenant les bureaux d’assaut. Il n’est pas enchanté et la collaboration ne sera pas fluide….
Ce récit nous montre les différences d’approche et de méthode de travail des deux groupes d’enquêteurs. Quentin et ses collègues décident de mener des investigations en toute discrétion, aidés de Léo et de ses enfants.
L’auteur aborde également les problématiques liées à l’écriture d’un roman. Les difficultés face à la page blanche et pour se faire connaître. La place des blogueurs, des réseaux sociaux qui influencent les futurs lecteurs, parfois sans avoir vraiment lus le recueil. C’est très intéressant parce qu’incontestablement bien « vu » et réaliste. Naëlle Charles sait de quoi elle parle !
Son écriture est enjouée, elle manie tous les langages et c’est extrêmement drôle lorsqu’elle donne la parole à son fils, d’autant plus qu’il n’a pas la langue dans sa poche et ses réparties sont hilarantes ! Il y a aussi quelques comiques de situation dans les situations amoureuses ou autres.
On alterne les chapitres entre Quentin et Léo qui prennent la parole et posent leur regard sur les événements et leurs ressentis. Ils sont souvent en train de se surveiller discrètement alors qu’ils répètent sans cesse que chacun fait ce qu’il veut. Léo est attachante, au fil des tomes, son lien avec sa frangine s’apaise et c’est une bonne chose.
J’aime beaucoup lire « Bigoudis et petites enquêtes », c’est plaisant, détendant et pas stupide du tout ! On se glisse dedans, une atmosphère faite de sourire, de bonne humeur et de surprise nous enveloppe et on est bien. C’est un moment de lecture sans prise de tête mais avec une intrigue « travaillée » où tout s’emboîte.
Éditions : L’Archipoche (2 Mai 2024)
ISBN : 979-1039205108
546 pages
Quatrième de couverture
Une nouvelle enquête s'annonce pour Léopoldine Courtecuisse, la coiffeuse de Wahlbourg. Cette fois, c'est sa sœur cadette qui est dans le viseur de la justice. Elle va mener l'enquête avec Quentin Delval, son lieutenant préféré, dessaisi officiellement de l'affaire. Ils vont devoir résoudre ce crime en secret au milieu du festival du livre de la ville.
01/05/2024 | Lien permanent
La couleur de la loi, de Mark Gimenez
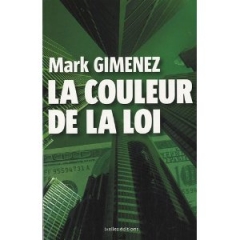 Une chronique de Christophe.
Une chronique de Christophe.
« La couleur de la justice n'est ni noire, ni blanche. Elle est verte, comme le dollar ! »
Le titre est une citation extraite d'un premier roman publié en français, dans une petite maison d'éditions belge, et ce polar judiciaire, qui se déroule à Dallas (dont on découvre une nouvelle facette de son univers impitoyable...) et dénonce la cupidité du petit monde des avocats, plus préoccupés de facturer des heures à des tarifs exorbitants à leurs clients qu'à rechercher la vérité... Ce roman s'appelle "la couleur de la loi" (traduction littérale du titre original, ce n'est pas si courant) et est signé par... un avocat ayant choisi de devenir romancier : Mark Gimenez (en grand format chez Ixelles éditions). Un roman qui recèle une très intéressante originalité...
Dans les années 2000, Scott Fenney est un avocat qui monte. Il travaille pour l'un des plus gros cabinets de la ville, s'occupe de dossiers très rentables, a l'ambition de prendre la tête du barreau de la ville, vit avec sa femme et sa petite fille de 9 ans dans le quartier résidentiel le plus huppé... Bref, ça va bien pour lui.
Lors d'un discours pour convaincre ses pairs de l'élire à la présidence du barreau, Scott, allègrement cynique, car sa seule motivation véritable est l'argent (qui donne pouvoir et position sociale), dénonce les dérives du système judiciaire, où la vérité n'a plus sa place, ou peu de lawyers travaillent pour faire le bien autour d'eux, mais plutôt pour tirer des bénéfices pas toujours mérités de leur travail.
Et, pour illustrer ce discours, Fenney a une figure tutélaire parfaite à mettre en avant : Atticus Finch, un avocat, lui aussi, personnage principal d'un des classiques de la littérature américaine : "ne tirez pas sur l'oiseau moqueur", de Harper Lee. Un livre que la mère de Fenney lui lisait quand il était enfant, espérant lui inculquer le sens de la justice et faire de son fils un nouvel Atticus Finch.
Mais, si le petit Scotty est bien devenu avocat une fois adulte, force est de reconnaître qu'il n'a pas suivi la voie souhaitée par sa mère. Son discours n'est qu'un argument de campagne pour séduire un auditoire et, une fois revenu dans son bureau, il redeviendra un requin sans foi, ni loi, se ce n'est celles de l'argent roi.
Pourtant, une personne dans l'auditoire a pris le discours de Fenney au sérieux : Sam Buford est juge à la cour fédérale, la plus haute instance judiciaire du Texas. En entendant la "profession de foi" de maître Fenney, il s'est dit qu'il pourrait être l'homme de la situation dans une affaire qui s'annonce au combien épineuse.
Alors, il appelle Scott Fenney et le commet d'office pour défendre Shawanda Jones, une jeune femme noire, originaire des quartiers les plus pauvres de la ville, une héroïnomane qui gagne de quoi se payer ses doses en se prostituant. Là voilà en prison, accusé du meurtre de ses clients, un blanc.
Et pas n'importe quel blanc : la victime, Clark McCall, est en effet le fils du sénateur Mack McCall, favori pour devenir le prochain président des Etats-Unis...
Pour ne pas perdre la face devant le juge Buford, Fenney n'a pas osé décliner l'offre. Mais il est d'abord un avocat d'affaires, pas un avocat pénaliste, habitué aux affaires, comme celle-ci, où la peine de mort peut-être requise. Et surtout, le temps qu'il va consacrer pro bono va l'empêcher de se consacrer aux seules affaires qui vaillent le coup, les affaires qui rapportent de l'argent.
Alors, il cherche comment se défiler... sans y parvenir, sous la pression du juge. C'est alors qu'il va découvrir qu'il y a bien pire que la pression de Sam Buford : celle de Mack McCall, homme d'influences, qui ne veut pas d'un procès pour la meurtrière présumée de son fils. Alors, il va tout mettre en œuvre pour détruire la "vie idéale" de Scott Fenney pour qu'il laisse tomber...
Voilà qui va faire tomber les écailles des yeux de Scott Fenney. Certes, il n'est pas encore le digne successeur d'Atticus Finch, car c'est avant tout pour se défendre lui-même des attaques qui le visent. Mais plus on cherche à le détruire, plus il se sent concerné par cette affaire (même s'il ne croit pas une seconde à l'innocence de sa cliente, que toutes les preuves paraissent accuser).
Il va alors renoncer à son statut social, à ses signes extérieurs de richesse, à son poste, à tout ce qui faisait le quotidien de Scott Fenney, pour se consacrer à cette affaire et comprendre enfin que le métier d'avocat, c'est aussi de rechercher la vérité et de faire le bien autour de lui.
Au-delà de l'histoire, polar judiciaire assez classique, c'est la relecture contemporaine de "ne tirez pas sur l'oiseau moqueur" qui est très intéressante. "La couleur de la loi" ne se déroule pas dans l'Alabama ségrégationniste des années 30, mais dans le Texas du début du XXIème siècle. Officiellement, il n'y a plus de ségrégation raciale. Pourtant, on peut considérer qu'elle s'exerce encore, de manière très différente : par l'argent et le statut social.
L'élite texane est blanche, anglo-saxonne et protestante, riche et sans scrupule. Mais aussi raciste de fait : noirs et hispaniques sont une infime minorité à occuper des postes importants, l'accès à nombre de clubs et de résidences ne leur est pas permis, sinon comme employés et, devant la justice, lorsqu'une affaire oppose un blanc à un noir, les préjugés l'emportent bien souvent sur la recherche de la vérité.
Mark Gimenez, avocat lui-même à Dallas, dénonce dans ce livre les dérives de cette élite et fustige le rôle des avocats, parfaits petits soldats, qui n'oublient pas de s'en mettre plein les poches tout en faisant tout pour maintenir cet état de fait. Des avocats qui vivent dans leurs tours d'ivoire et de verre bien climatisée en oubliant complètement qu'il y a une vie différente, difficile, au pied des gratte-ciel.
Et son personnage central lui aussi va redécouvrir cela par la force des choses et se souvenir d'où il vient. Car Fenney n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, il n'est pas un "fils de" (comme ce dépravé de Clark McCall), il ne doit son statut qu'à sa propre réussite. D'abord comme footballeur. Star de son université, il a accumulé les records, obtenant une bourse qui lui a permis de faire son droit. Ensuite, comme avocat, puisqu'il est sorti major de sa promotion avant d'intégrer un cabinet prestigieux et d'en devenir l'un des plus jeunes et prometteurs associés.
Mais jamais il n'a appartenu à cette caste des gens riches. Il s'y est intégré parce que la société dans laquelle il évolue est celle du paraître, de l'aisance étalée à outrance, de "l'inceste social" d'une classe sociale qui vit refermée sur elle même, excluant le reste du monde qui n'a, à leurs yeux, aucune existence propre...
On a quitté les Ewing et leur empire pétrolier qui avaient déjà fait une belle réputation à Dallas pour découvrir que cette ville est décidément tout sauf l'image d'Epinal du rêve américain. Si tout à changé depuis les années 30, Gimenez montre qu'en fait, la situation reste hélas la même dans les faits. Précisons que le roman est paru en Europe en 2010, mais aux Etats-Unis en 2005, soit avant l'élection de Barack Obama à la présidence. Un évènement historique intervenu entre temps qui ne remet pas du tout en cause, malheureusement, cette situation...
Au-delà de ces aspects sociaux et politiques (car la lâcheté et l'ambition touchent évidemment ceux qui briguent des mandats, le seul personnage courageux étant Buford, le juge fédéral, qui n'a rien à perdre puisque nommé à vie), il y a dans ce livre un très intéressant travail autour du roman de Harper Lee pour dessiner un parcours, non pas parallèle mais convergente, entre les destins de Finch et de Finney. Ceux qui ont lu et apprécié "ne tirez pas sur l'oiseau moqueur" devraient repérer les nombreux clins d'oeil que Gimenez a placé dans son récit.
Pour finir, un mot des deux enfants présentes dans ce livre dur, sans concession. Pam, la fille de Fenney, et Trisha, la fille de Shawanda Jones, l'accusée, sont une oasis de fraîcheur et de candeur dans cet univers de cynisme et de duplicité. Pam, c'est ma voix de la conscience de Fenney ; Trisha, c'est la preuve que de jolies fleurs peuvent éclore sur les pires terreaux. Et, à elles deux, elles vont devenir les moteurs de Fenney, celles dont il a la responsabilité, celles qu'ils voudraient rendre fières, celles pour lesquelles il se doit de devenir l'exemple qu'il n'a pas vraiment été jusque-là.
Leurs sourires comme leurs larmes n'ont rien des sentiments feints que ne cesse de côtoyer Fenney dans son travail dépourvu de toute humanité. Avec la naïveté de leur jeune âge, elles lui assènent des vérités imparables, mettent le doigt sur la perversité du monde qui les entoure, le mettent en porte-à-faux entre sa situation et ses idéaux oubliés.
Et tant pis si pour retrouver ces fameux idéaux, que sa défunte mère lui avaient enseignés quand il avait lui-même l'âge de Pam et Trisha, il doit laisser derrière lui irrémédiablement tout ce qui faisait sa grandeur, tout ce qui faisait son statut social, tout ce qui faisait... les apparences. Pour elles, l'être doit reprendre le dessus sur le paraître.
Il n'est pas encore Atticus Finch, mais il est désormais sur le bon chemin...
Christophe
http://appuyezsurlatouchelecture.blogspot.com/
La couleur de la loi
Mark Gimenez
Ixelles édition (sept. 2011)
21,90 €
31/10/2011 | Lien permanent
La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert, de Joël Dicker (chronique 2)
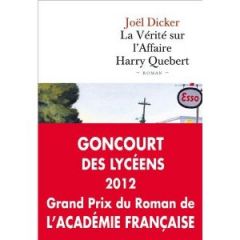 Une chronique de Richard.
Une chronique de Richard.
Vous n’avez pas encore entendu parler de «La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert» ? Et bien tant mieux !
C’est que vous ne l’avez pas encore lu et qu’il vous reste tout le plaisir de découvrir un excellent roman !
Lisez ma chronique !
Laissez-vous convaincre !
Et allez chez votre libraire préféré vous procurez ce roman !
Dès les premières pages, vous serez pris par l’histoire, vous vous laisserez emporter par les personnages et vous ne quitterez plus le récit tant que vous n’aurez pas lu le chiffre 665, au bas de la dernière page.
Bonne lecture !
Voilà !
Je termine toujours mes chroniques avec ces mots : «Bonne lecture !» Ce que j’ai écrit devrait vous suffire à vous convaincre ... Mais je vous connais, chers lecteurs, vous voulez en savoir plus ! Pas question de faire confiance au blogueur sans quelques preuves, commentaires et extraits ... Moi qui pensait pouvoir profiter de cette pause, illustration de ma paresse légendaire. Écrire une chronique d’un paragraphe et savoir que je vous ai convaincu !
Et non !
Ce ne sera pas pour cette fois-ci !
Alors, blogueur paresseux, au clavier !
Parle de cet excellent roman. Raconte-nous un peu l’histoire, pour nous mettre en appétit et dis-nous pourquoi, nous devrions lire ce deuxième roman de Joël Dicker.
Marcus Goldman, jeune écrivain, a connu un succès extraordinaire avec son premier roman. Reconnu par le tout New-York, vedette sous les feux de la rampe, il souffre cependant du syndrome de la page blanche. Bloqué, sans inspiration, l’imagination au neutre, il est en plus harcelé par son éditeur qui s’attend à un deuxième succès, le plus tôt possible.
Pour se ressourcer, Marcus se rend chez son vieux professeur d’université, Harry Quebert pour recevoir ses précieux conseils et surtout, retrouver l’inspiration et l’imagination qui l’ont abandonné. Mais Harry Quebert, un des écrivains les plus appréciés au pays, voit une vieille histoire d’amour resurgir 35 ans plus tard. Il est accusé du meurtre de cette jeune fille de 15 ans dont on vient de retrouver le corps dans son jardin. Avec le manuscrit de son grand succès !
Marcus Goldman ne croit aucunement à la culpabilité de son mentor et commence alors sa propre enquête pour découvrir la vérité.
Dans ce petit village d’Aurora dans le New Hampshire, Goldman se heurtera à l’opacité et à la haine, exacerbées par la découverte de ce squelette. Accompagné par un policier débonnaire mais efficace, le Sergent Perry Gahalowood, Goldman retracera événement par événement ce qui s’est passé, 35 ans plus tôt. Et tout au long de son enquête, il amènera le lecteur à déchiffrer les indices, à infirmer des hypothèses et à se prendre dans la toile que ces écrivains ( le vrai, Joël Dicker et ses deux personnages ... !) lui tissent dans une finale tout à fait inattendue mais parfaitement crédible.
Voici donc l’histoire !!
Mais non !
Ce n’est pas tout !
Car dans ce roman, il y a l’histoire d’un roman sur un roman !
(Hum ! j’adore me permettre cette répétition ! )
En effet, pour guérir son syndrome de la page blanche et surtout pour calmer l’appétit féroce de son éditeur avide et affamé, Marcus Goldman tentera d’écrire l’histoire de cette enquête. Et l’histoire du roman dans un roman, lui permettra également de revoir les 31 conseils, qu’un jour, son maître Quebert lui a donnés pour devenir un grand écrivain.
«J’aimerais vous apprendre l’écriture, Marcus, non pas pour que vous sachiez écrire, mais pour que vous deveniez écrivain. Parce qu’écrire des livres, ce n’est pas rien: tout le monde sait écrire, mais tout le monde n’est pas écrivain.
- Et comment sait-on que l’on est écrivain, Harry ?
- Personne ne sait qu’il est écrivain. Ce sont les autres qui lui disent.»
Ces 31 conseils nous sont révélés, au fur et à mesure, en tête de chapitre ... numérotés de 31 (le premier chapitre) à 1 (le dernier). Juste avant l’épilogue !
Quoi dire et qu’ajouter à cette histoire ?
Mais qu’il ne faut pas oublier que derrière ces 35 années qui séparent le meurtre de la découverte du corps, les États-Unis ont vécu. Et Joël Dicker, en filigrane, nous raconte cette Amérique, vue dans la lorgnette de ce petit village du nord-ouest du pays. À travers les yeux de ses habitants, leurs peurs et leurs croyances, l’auteur nous dessine le portrait de ces personnages, aussi réaliste et coloré qu’une toile d’Edward Hopper.
Ce deuxième roman de Joël Dicker sort vraiment des sentiers battus littéraires: inclassable et atypique, inutile d’essayer de le faire entrer dans une case quelconque. L’auteur nous raconte une bonne histoire et il la raconte très bien. Aucun temps mort, des revirements spectaculaires, une galerie de personnages qui nous rappellent tous quelqu’un qu’on a déjà rencontré. Et une victime extraordinaire, une victime qui nous pose elle-même son propre problème. Une victime qui nous laisse à chaque fois, un peu plus perdu, un peu moins certain sur l’identité de son meurtrier. Nola est un personnage fascinant, énigmatique et tout à fait crédible; sa disparition quand elle n’a que 15 ans, cache un être complexe qui donne de la profondeur et de la consistance à l’intrigue.
Les relations presque paternelles mais assurément pédagogiques, entre Harry et Marcus révèlent également toute la complexité du récit. Un roman sur le roman, oui ! Mais aussi, un roman sur la confiance, l’amitié, confrontés à la suspicion, l’avidité et la recherche du bonheur à tout prix.
Joël Dicker est un excellent raconteur d’histoires, un romancier dans le sens balzacien du terme. Vous ne trouverez pas dans « La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert» une prose poétique ou un style charmeur. L’auteur sait nous raconter une histoire pour nous divertir et nous émouvoir. Cependant, il me faut souligner le sens de l’humour de Dicker, révélé dans les dialogues savoureux et distrayants de Marcus Goldman avec sa mère. Véritable caricature de la mère surprotectrice pleine de préjugés, chacune de ses présences nous fait sourire autant qu’elles incommodent son fils. Certaines réparties sont savoureusement choquantes, pournotre plus grand plaisir.
«Markie chéri, écoute, je dois te demander: es-tu amoureux de ce Harry? Fais-tu de l’homosexualité avec lui ?»
Je vous invite donc à vous plonger dans cet excellent roman qui a déjà reçu le Prix du roman de l’Académie française et le Prix Goncourt des lycéens. Un petit voyage dans le nord des États-Unis qui vous ravira. Avec en prime, la recette pour écrire un best-seller !
Un dernier commentaire avant ces quelques extraits ! Une interprétation personnelle sur le succès de ce roman. Je crois que Joël Dicker est amoureux de la littérature et par ce fait, il partage avec ses lecteurs cet amour et cette passion. Le lecteur se sent complice, l’auteur lui parle, lui raconte une bonne histoire complexe et prenante ... et la magie opère. On sort de cette lecture en ayant l’impression d’avoir vécu (lu ?) un moment bien particulier, d’avoir lu (vécu?) quelque chose de vrai.
Voici donc quelques extraits.
« Elle avait quinze ans, c’était un amour interdit. N-O-L-A.»
«Les mots sont à tout le monde, jusqu’à ce que vous prouviez que vous êtes capable de vous les approprier. Voilà ce qui définit un écrivain. Et vous verrez, Marcus, certains voudront vous faire croire que le livre est un rapport aux mots, mais c’est faux: il s’agit en fait d’un rapport aux gens.»
«Je range les chariots, Marcus. Je parcours le parking, je traque les chariots esseulés et abandonnés, je les prends avec moi, je les réconforte, et je les range avec tous leurs copains dans la gare à chariots, pour les clients suivants. Les chariots ne sont jamais seuls. Ou alors pas très longtemps. Parce que dans tous les supermarchés du monde, il y a un Ernie qui vient les chercher et les ramène à leur famille. Mais qui est-ce qui vient chez Ernie ensuite pour le ramener à sa famille, hein ? Pourquoi fait-on pour les chariots de supermarché ce qu’on ne fait pas pour les hommes ?»
«Au fond, dit-il, les écrivains n’écrivent qu’un seul livre par vie.»
Alors, «La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert» sera-t-il le dernier livre de Joël Dicker ?
Bonne lecture !!
Richard, Polar Noir et blanc
A lire : la chronique de Paco sur ce roman.
La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert
Joël Dicker
Éditions de Fallois / L’Âge d’Homme
2012
665 pages
19/12/2012 | Lien permanent
La chute de M. Fernand, de Louis Sanders
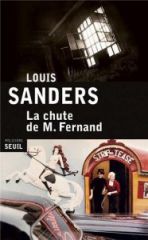 Une chronique de Paul.
Une chronique de Paul.
Il faut distinguer le vrai du faux du faux du vrai !
Hiver 1979. Le corps qui dépasse de la poubelle d'une boîte de nuit des Champs Elysées n'est pas celui d'un fêtard nocturne aviné, mais celui de Fernand Legras, célèbre marchand de faux tableaux de maîtres. Même l'homicide semble faux, perpétré à l'aide d'un pic à glace comme dans les vieux romans policiers. Et pour faire bonne mesure dix-sept coups ont été assenés. Le commissaire Cabrillac est chargé de l'enquête.
Hiver 1978. Avec son manteau à poils noirs, de la peau de gorille, son chapeau à large bord et sa bimbeloterie autour du cou, Monsieur Fernand ne passe pas inaperçu dans le quartier de Pigalle en cette fin de décennie soixante-dix. Mais les habitants ne savent pas que ses babioles tintinnabulantes sont en or, et non point du toc.
S'il vit dans un hôtel, il possède ses habitudes au 11 boulevard de Clichy, au fond de la cour de l'immeuble, chez Jimmy Fallow un Américain qui a débarqué en 1944 puis a déserté, et sa femme Annie et le fils d'Annie. Elle aimerait bien que Fernand donne un coup de pouce à son rejeton, lui ouvrant les portes d'un studio d'enregistrement. Ils ne roulent pas sur l'or mais possèdent toujours une bouteille de whisky coûteux et goûteux à proposer. Dans la pièce où il est reçu il y a aussi Karl, son secrétaire garde du corps chauffeur et amant. Sans oublier sa petite chienne Jouvencelle qui lui fait la fête comme si elle ne l'avait pas vu depuis... la dernière fois. Parmi les autres locataires de l'immeuble il faut citer aussi Kowalski, un peintre et sa femme Irène qui enseigne le français dans un lycée proche. Elle a publié deux romans mais ce n'est pas ça qui fait vivre le ménage. Un autre peintre, mondain, du nom de Sicard vit également au fond de la cour et il ne faut pas oublier la Baronne, et le fils de la Baronne. Vieille noblesse mais riche de son passé et de meubles d'origine véritable ainsi que de tableaux de maitres, la Baronne est entourée de poussière et d'un fils drogué, dont le dernier amant en date est un travesti.
Monsieur Fernand n'a plus l'aura d'antan, lorsqu'il voyageait souvent hors des frontières, se rendait aux Etats-Unis, s'affichait au bras de Marilyn Monroe, mais il est encore sollicité parfois par des amateurs d'art. Ainsi il lui faut trouver un tableau de Dufy pour un truand corse, et il se retourne vers son fournisseur habituel, Bronstein, qui lui-même travaille avec des sous-traitants. Seulement les faussaires capables de pouvoir honorer la commande sont partis au Brésil ou sont cachés dans la nature ou en prison.
Monsieur Fernand est un homme charmant, aimable, onctueux, quand il le veut, mais il sait aussi se montrer exigeant, colérique et jaloux, surtout lorsqu'il a abusé du breuvage écossais, ce qui lui arrive souvent. Principalement envers Karl, qu'il n'aime pas voir tourner autour des femmes, ou envers ses amis, qu'il ponctionne sans vergogne. Pourtant lorsqu'il se rend au Favori, sa cantine, un club de strip-tease, il se fait conduire en Rolls Silver Shadow blanche.
Il fournit la Baronne en petits sachets de poudre, une friandise dont elle est gourmande tout comme son fils. Elle a beau les cacher mais il finit toujours par en trouver obligeant sa mère, septuagénaire, à pleurer dans le giron de Monsieur Fernand. Et c'est comme cela, alors qu'il l'entend se plaindre et pleurer parce que le rejeton a une fois de plus fait main basse sur son trésor en poudre, que Monsieur Fernand découvre qu'elle possède un véritable Dufy.
raoul_dufy-Tour-Eiffel.jpgPendant ce temps le commissaire Cabrillac, dont la femme est une ancienne prostituée qui exerçait ses talents en Dordogne, est chargé d'une enquête sur le meurtre d'une hôtesse qui se faisait payer pour s'envoyer en l'air. C'est un peu à cause de ce passé pesant et à cause de méthode expéditive qu'il a été muté au 36 quai des Orfèvres. Un certain Le Guen, des R.G., demande à le rencontrer. Ce n'est pas le passé de l'épouse de Cabrillac qui l'intéresse mais les relations entre Fernand Legras et le truand corse Albertini. Et surtout il veut découvrir l'identité du faussaire.
Le lecteur ne pourra s'empêcher d'établir une corrélation entre ce Fernand legrosFernand Legras à Fernand Legros, célèbre marchand d'art américain d'origine française qui fut traduit en justice à la fin des années 1970 pour vente de faux tableaux et qui mourut en 1983 d'un cancer. D'ailleurs il existe de nombreuses ressemblances entre les deux hommes. Et pas seulement patronymique ou presque. Monsieur Fernand a passé son enfance à Alexandrie, est un ancien danseur mondain, et est en attente d'un procès. Pour le reste tout est fiction, ou presque.
Amusant de lire aussi qu'une certain chanteur s'appelle Francis Claude, un petit clin d'œil, et qu'un avocat réputé du nom de Dejoint-Dancourt défend les intérêts de Fernand Legras. On pourrait remplacer Dejoint-Dancourt par Tixier-Vignancourt, célèbre avocat qui défendit des personnalités comme Raoul Salan ou Céline, qui se présenta aux élections présidentielles de 1965 et avait comme directeur de campagne un certain Jean-Marie Le Pen.
Le décor est important dans ce roman, tout autant que les personnages. Nous sommes dans une sorte de vase clos, trimballé entre Pigalle et les Champs Elysées. Les bars, les boîtes de nuit, les clubs de strip-tease avec hôtesses d'accueil parfois défraichies sont toujours présents, quant aux ateliers d'artistes, situés en haut des immeubles ou dans les arrière-cours d'immeubles ils sont transformés pour la plupart en loft pour bourgeois bohêmes. Louis Sanders met l'accent sur la déchéance d'un homme qui a connu la gloire, a beaucoup voyagé, a possédé des résidences un peu partout de par le monde, et jusqu'à six Rolls, et qui est obligé malgré les colifichets en or qu'il porte autour du cou, de quémander des billets de cent francs (environ quinze euros de nos jours) aux uns et aux autres, leur narrant en contrepartie ses mémoires. Fernand Legras fascine, surtout les femmes, hypnotise presque, déçoit parfois, mais ne laisse personne indifférent, pas même le lecteur.
Paul (Les lectures de l'oncle Paul)
La chute de M. Fernand
Louis SANDERS
Collection Policiers Seuil.
Editions du Seuil. Parution le 6 février 2014.
240 pages. 18,50€.
01/03/2014 | Lien permanent
« Mais je fais quoi du corps ? », d’Olivier Gay
 Une chronique de Jacques.
Une chronique de Jacques.
Nous le savons : l’incipit d’un roman donne parfois un aperçu de sa tonalité générale, une idée de son style, et dans le cas d’un polar il peut être aussi une clé qui nous ouvrira les portes de l’énigme, le vaste champ du suspense que nous, lecteur, attendons avec une impatience frémissante.
Ici, dès le prologue, nous découvrons l’efficacité du style de l’auteur, sa façon de happer l’intérêt du lecteur, la légèreté de son écriture, sa concision et son efficacité.
« D’après sa carte d’identité, elle s’appelait Coralie Edelmar. D’après son extrait de naissance, elle avait vingt-six ans. D’après ses fiches de paie, elle travaillait chez Microsoft France. Tout cela était faux. D’après ses parents, elle était surdouée – et ça, s’était vrai ».
Qui est cette jeune femme mystérieuse ? Quel rôle va-t-elle jouer dans l’histoire ? Il nous faudra pas mal de temps pour le découvrir, d’autant plus qu’à la suite du prologue, c’est le narrateur qui va prendre le relai et nous emporter dans un suspense fiévreux, avec une série de personnages dangereux, des questions sans réponses, une angoisse suscitée par l’auteur sur la question de l’avenir du héros de l’histoire.
Un héros éminemment sympathique. Certes, son métier de dealer de cocaïne n’est pas spécialement valorisé par les médias, même si certains journalistes ont la réputation d’être eux-mêmes de solides consommateurs de la chose, mais si John-Fitzgerald, alias Fitz, est un beau gosse au cœur d’artichaut et aux multiples conquêtes féminines, un spécialiste des nuits branchées parisiennes, il est aussi un garçon qui adore sa famille et prend la vie comme elle vient, avec décontraction et simplicité. Un jeune homme aussi généreux que fiable, des qualités qui lui permettent de conserver l’amitié fidèle de ses deux potes : Déborah, jolie prof de ZEP dans la banlieue et Moussah, grand black jovial travaillant dans la sécurité.
Fitz, qui a interrompu un repas de famille dans lequel il avait entrainé Déborah pour aller approvisionner en poudre blanche le médiatique député Georges Venard, découvre ce dernier à son domicile, tout ce qu’il y a de plus mort. Occis ? Suicidé ? Dans un premier temps, la police semble ne pas savoir, mais pour Fitz, les ennuis commencent.
Bob, un mystérieux hacker qu’il n’a jamais rencontré, mais avec qui il entretient de bonnes relations, rend une petite visite à son appartement à travers son ordinateur qui est resté branché, comme il le fait souvent. Il le prévient que des hommes sont chez lui avec des intentions qui semblent un tantinet suspectes, tellement suspectes que l’un d’eux déclare au téléphone à son présumé commanditaire « ... mais je fais quoi du corps ? ».
Tout bascule pour Fitz, garçon plutôt pacifique qui ne se connait pas d’ennemi. Dans son désir de comprendre ce qu’il se passe et son souci de sauver sa peau, il va aller au-devant d’aventures aussi rocambolesques que palpitantes pour le lecteur, qui vont nous tenir en haleine pendant les 300 pages du roman.
Il faut dire qu’Olivier Gay a une façon percutante de raconter son histoire. Les descriptions de ses personnages sont incisives, plaisantes et sonnent juste, comme lorsque Fitz nous parle d’Howard, son frère, avec qui il entretient un rapport ambivalent de rivalité affectueuse :
« Je n’ai rien contre Howard. Comme tous les grands frères, il m’avait volé des jouets lorsque j’étais plus petit, m’avait enfermé dans la salle de bain lorsque les parents n’étaient pas là et avait piétiné mes châteaux de sable. Mais je n’étais pas le genre d’homme à garder de la rancœur pour des batailles enfantines, et nos relations avaient su évoluer à l’adolescence, puis à l’âge adulte. Pendant un certain temps, il avait même été un modèle pour moi – études brillantes, esprit brillant, amis brillants. Beaucoup de lumière en une seule personne. Nous avions trois ans d’écart et trois zéros de différence sur nos comptes en banque. Il avait suivi la voie royale, classe préparatoire, école de commerce, payée à la sueur de son front et de journées passées à préparer des hamburgers derrière des comptoirs de tel ou tel fastfood. Il avait des dents aussi longues que ses cheveux étaient courts, sagement coiffés en une brosse militaire ; il investissait des sommes folles dans des costumes à la sobriété déprimante ».
À travers les coups de théâtre et les rapports parfois compliqués que le narrateur entretient avec les femmes de l’histoire (Déborah ainsi qu’une ancienne petite amie de Fitz, qui est commissaire de police), l’intrigue se dévoile peu à peu, et nous commençons à en comprendre les enjeux. Naturellement, l’auteur conserve pour la fin quelques munitions qui procureront au lecteur un effet de surprise bienvenu.
Tout comme Les talons hauts rapprochent les filles du ciel et Les Mannequins ne sont pas des filles modèles, ce troisième polar d’Olivier Gay est lui aussi un roman-champagne : pétillant, léger, il s’absorbe avec gourmandise d’une seule traite. Quand il se termine, nous oscillons entre le regret de l’avoir achevé et l’espoir d’ouvrir bientôt une nouvelle bouteille d’Olivier Gay. Ce « Mais je fais quoi du corps ? » est un excellent cru.
À déguster sans modération !
Jacques, lectures et chroniques
Mais je fais quoi du corps ?
Olivier Gay
Editions Le Masque
301 pages ; 16 €
10/12/2013 | Lien permanent
Petit papa Noël, de François Cérésa
 Une chronique d'oncle Paul
Une chronique d'oncle Paul
On trouve de tout dans les caves d’immeubles. De la poussière, des toiles d’araignées, de vieux objets dont on ne se débarrasse pas par sentimentalisme, des rats crevés, des ramas entreposés à la va-vite, des bouteilles, le plus souvent vides, et parfois même il arrive que l’on débusque un squatteur.
Pour une vague histoire de passage de câbles, Jacques Villeneuve descend à la cave, mais l’employé asthmatique ne veut pas continuer, une grosse pierre fichée dans le sol l’empêchant de travailler. Plus tard Jacques arrive à desceller ce qu’il croit être un gros caillou, et quelle n’est pas sa surprise de découvrir qu’en réalité il s’agit d’un coffre contenant dix petits sacs, une fortune en pièces d’or. Sa voisine Ludivine le surprend et après une petite gâterie qui fait du bien aux deux protagonistes, il ne peut s’empêcher de vendre la mèche. Du coup il lui faut bien faire part de sa trouvaille aux autres copropriétaires de l’immeuble.
Mais présentons ce microcosme : Jacques Villeneuve, qui oscille entre la cinquantaine et la soixantaine, sans travail, amoureux de Mozart auquel il a consacré une étude qui a connu un succès inespéré et continue dans l’écriture. Il absorbe régulièrement ses verres d’huile afin de se graisser les neurones. Ondine, sa compagne, sa cadette de vingt ans, est quelque peu folâtre, et sans aucun complexe, surtout lorsqu’il s’agit de dépenser l’argent de Jacques. Ludivine, rousse flamboyante, très portée sur la fellation, ce qui est peut-être la cause de sa propension à employer un mot pour un autre, et mère de Greg, un gamin qui veut à tout prix se fourrer la tête dans une bonbonnière et dont la conversation se limite à des aga, aga. Aurore possède un chien, un chowchow nommé Mao, un chat qui répond au nom de Tsé Toung, un perroquet, et n’est pas franchement affriolante avec sa tête de gargouille. Ensuite, Gérard, qui habite la loge de concierge, ancien typographe à la retraite et s’amuse à tirer sur les pigeons se nichant dans le marronnier du jardinet. Cédric, prof de lettres, ancien maoïste, pince-sans-rire, citant à tout propos Baudelaire, appréciant les boissons fortes et les films d’horreur. Le docteur Schlick est un cas lui aussi : affligé d’une coquetterie oculaire, les cheveux gominés, le stéthoscope en bandoulière, affublé d’une blouse blanche, débordant de vitriol avec une tête pleine de clochettes, il a une bonne (à tout faire ?) nommée Mélia. Enfin le seul couple officiel de l’immeuble, les Benabid, surnommés avec ironie Benaventre par Schlick. Ils ont recueilli leur petite fille Nébia à la mort de ses parents dans un accident, Nébia qui aime grimper dans le marronnier au grand dam de Gérard qui a peur de toucher la gamine de dix ans en tirant sur les pigeons.
Maintenant que tous les personnages principaux vous ont été présentés, introduisons-nous subrepticement dans l’appartement du docteur Schlick qui organise un repas afin de réunir tous ces copropriétaires face à cette manne tombée de la cave. Seulement le cochon de lait et le lapin prévus au programme des réjouissances gustatives ne sont pas exactement les animaux servis dans les assiettes des convives. C’est ce que Mélia découvre en tournant de l’œil en ouvrant sa cuisinière. Figurez-vous son étonnement, et son horreur, en se retrouvant nez à nez avec les têtes de Mao (le chien) et de Tsé Toung (le chat) les animaux d’Aurore qui n’avaient aucunement besoin de se réchauffer mais se retrouvent refroidis par la malice d’un petit malin qui se joue des nouveaux millionnaires en herbe (de Provence). Un coup de froid pour Aurore qui perd la raison et est hospitalisée. Quand la bague de Gérard, qui n’a pas donné de ses nouvelles depuis quelque temps, est retrouvée dans le ventre d’un poisson acheté sur le marché, l’inquiétude grandit. Ce n’est pas encore l’affolement mais tout le monde se pose des questions. D’autant plus que les décès, accidentels apparemment, se succèdent. Les optimistes se consolent en se disant que moins de monde il y aura à se partager la galette, plus les parts seront conséquentes.
Petit papa Noël, dont le titre trouve sa justification dans le déroulement du récit, nous emmène un peu sur les traces d’Agatha Christie et à son célèbre roman Les dix petits nègres. Un hommage mais en même temps une œuvre personnelle, avec une trame humoristique, comprenant de très nombreuses références cinématographiques et littéraires. Ce qui n’empêche pas l’auteur, au contraire, de placer des coups de griffes qui trouvent leur justification dans un contexte actuel. Ainsi Cédric, prof de lettres je le remémore, se positionne en se posant des questions fondamentales : « S’il ne pouvait pas donner ses cours sans risquer des insultes et même des coups, il se sentait en droit de demander des comptes à la République. Tous ces politiques, syndicalistes et intellectuels qui s’exprimaient à la place des profs, des gens de terrain, il les maudissait ».
Mais restons philosophes, quelles que soient les circonstances. Et si comme Jacques Villeneuve, le héros de ce roman et non l’ancien champion automobile de formule 1, vous demandez à votre compagne lorsqu’elle se rend à un rendez-vous : « Et tu vas y aller comme ça, en mini et en string ? », ne vous étonnez pas si elle vous rétorque : « Le string, personne ne le voit. La mini, c’est la mode », il est évident que vous aurez posé la mauvaise question, au mauvais moment.
Petit papa Noël
François CERESA
Pascal Galodé éditeurs. 1
84 pages.
17 €.
07/01/2012 | Lien permanent
La nuit des albinos, de Mario Bolduc
 Une chronique de Richard.
Une chronique de Richard.
Mario Bolduc est un de mes auteurs favoris. Chacun de ses romans est l’occasion de découvrir un monde, des événements réels, des atmosphères étranges; son intrigue se place dans un contexte politique ou social, dans des pays souvent mystérieux et même dans des situations provoquées par une certaine violence. Les polars de Mario Bolduc sont des occasions d’apprentissage, des plaisirs de lecture qui font appel à la curiosité du lecteur et à son sens de la découverte. Les romans de Mario Bolduc n’ont qu’un seul défaut ! Ils se font rares !
Et à la lecture de ceux-ci, on comprend pourquoi.
«Cachemire» publié en 2004, son premier roman, nous présentait son personnage principal, Max O’Brien, un escroc de haute voltige, toujours à l’affut du coup fumant qui lui rapportera le plus. Plus Robin des Bois que criminel notoire, il s’attaque aux riches et par une certaine forme de morale très personnelle, il est épris d’un sentiment de justice qui le place au centre d’enquêtes dans lesquelles il se mouille avec passion. Spécialiste du prête-nom, de la fausse identité, recherché par la police, il enquête sans moyen autre que son intelligence et sa perspicacité.
Cette première intrigue place Max au centre d’une Inde en pleine «guerre froide» avec le Pakistan, dans un climat explosif d’armes nucléaires ... Passionnant !
Dans son deuxième roman, «Tsiganes», l’auteur nous plonge dans la Roumanie d’après Ceaucescu. Max O’Brien est à la recherche de son ami, accusé des meurtres de Romanichels dans un squat où il aurait mis le feu. Ce roman est un des meilleurs que j'ai lu au cours des dernières années.
Et enfin, Max nous revient dans ce troisième roman «La nuit des Albinos», au coeur de la Tanzanie, de Dar es-Salaam à Bukoba, sur les bords du lac Victoria. Toujours amoureux de Valéria Michieka, l’avocate tanzanienne, il apprend son assassinat et celui de Sophie, la fille de Valéria. Il n’en faut pas moins pour que Max se mette à la recherche de l’assassin de celle qu’il aime encore, malgré leur séparation.
Sa quête de la vérité lui fait découvrir une Afrique résolument tournée vers la modernité mais encore marquée par ses croyances et ses superstitions. La Tanzanie (un fait véritable découvert en 2007) tente de mettre fin à un commerce inhumain, le massacre des Albinos, ces Noirs à la peau blanche à qui l’on prête des pouvoirs surnaturels. Partout au pays, les Albinos sont victimes de meurtres, d’enlèvements, de mutilations, dans le seul but d’en faire des objets de culte ou des amulettes.
Valeria défendait ardemment le droit des Albinos, participait à leur protection. Et en même temps, elle militait pour le rétablissement de la peine de mort pour les personnes trouvées coupables de ces horreurs. Sa mort était-elle la conséquence de ce combat ? Pourquoi, juste avant ce double assassinat, sa fille Sophie était-elle venue demander de l’aide à Max ? Qui a profité du million de dollars "durement gagné" par Max pour renflouer la caisse du centre d'aide de Valeria ?
Pendant ce temps, de l’autre côté de l’Atlantique, dans une petite ville du Texas, Albert Kerensky, bourreau à la retraite, («Un bourreau qui n’a jamais fait de mal à une mouche ...») expert de l’injection létale, a disparu de son centre pour personnes âgées. Dès sa retraite amorcée, il a quitté sa femme pour habiter cette maison de Huntsville, dans une chambre dont la fenêtre donne directement sur Walls Unit, la prison où il a travaillé durant toute sa vie.
Aujourd’hui, il a disparu ! Roselyn, sa femme, part à sa recherche à travers le Texas, jusqu’à Chicago, en découvrant une facette cachée de son mari, une zone obscure, une découverte macabre qui bouleverse Roselyne. Mais qui était véritablement Albert, son mari ?
Mario Bolduc nous sert un très bon roman alliant une intrigue prenante, une atmosphère angoissante et horrifiante et des personnages crédibles. Cette chasse à la vérité, enfouie sous l’horreur du massacre des Albinos, nous fait découvrir une Tanzanie habitée par certains personnages formés (ou déformés ...) par la guerre faite à Idi Amin Dada, l’ancien dictateur de l’Ouganda. Et tout cela dans un décor fascinant où on se demande comment on peut perpétrer des actes aussi sordides, où on imagine mal les horreurs, résultats de cette terrible «kandoya», un supplice terrible inventé par le corps d’élite de l’armée ougandaise !
Ces allers-retours entre le Texas et la Tanzanie vont évidemment nous transporter quelque part sur la planète, pour nous déliver une finale toute en finesse, en sensibilité mais aussi marquée par la violence et la cupidité.
Dans un style franc et direct, Mario Bolduc nous raconte cette histoire sans ménagement et avec une précision chirurgicale. Il nous montre l’Afrique dans ce qu’elle a de plus laid, de plus inhumain, étouffée entre sa modernité et ses croyances. Mais aussi, dans toute sa beauté ! Et l’Amérique, il ne l’épargne pas ! Mais comme dans ses deux premiers romans, ses personnages nageant dans une certaine ambiguïté, font quand même preuve d’une certaine humanité. Tantôt coupables, tantôt innocents, escroc sympathique ou femme de vengeance, le lecteur est toujours confronté à ces personnages complexes, mais tellement humains.
On ressort d’une lecture comme celle-ci, un peu secoué. Se félicitant d’avoir choisi et lu un auteur qui s’adresse à notre intelligence et à notre sensibilité. Je dirais même qu’on en ressort plus intelligent, du moins moins ignorant. Je vous mets au défi de lire «La nuit des Albinos» sans que vous ayez le goût de consulter un dictionnaire ou une encyclopédie virtuelle. Et peut-être que comme moi, vous consulterez les journaux de l’époque pour confirmer la véritable existence de l’horreur que Mario Bolduc nous fait découvrir.
«La nuit des Albinos» est un excellent polar, d’une justesse incroyable, d’une humanité sensible et réelle. Je vous le recommande sans aucune réserve. Et comme moi, vous deviendrez un «fan» de Max O’Brien ... et de son créateur.
Quelques extraits:
Premièrement, rencontrez donc M
ax O’Brien:
« - Je suis un escroc. Ma spécialité: des milliardaires comme vous, Harris, imbus de leur importance, et dont l’argent brûle les doigts. Les types de votre espèce, je les ai toujours méprisés. Vos discours ronflants, votre générosité de pacotille, vos bonnes intentions dégoulinantes d’hypocrisie, je n’ai jamais pu supporter. Contentez-vous de faire de l’argent, Harris, sans vouloir imposer votre morale de merde à qui que ce soit.»
«Ils n’avaient rien à se dire, comme si l’importance de ce qu’ils allaient accomplir les laissait sans voix, tout à coup.»
«La superstition existait sans mode d’emploi.»
« Ce jour-là, comme d’habitude, Max avait eu envie de se précipiter sur la plage et de crier son nom, de serrer Valéria bien fort dans ses bras, pour effacer les erreurs et les drames, pour l’obliger à le regarder lui, plutôt que de regarder à travers lui, ce qu’elle avait toujours fait.»
"Il s’en voulait de ne pas avoir pris les devants, de ne pas avoir agi quand il en avait l’occasion. D’avoir tenté de jouer au plus malin avec la vie, le destin ignorant volontairement qu’à ce petit jeu nous sommes de vulgaires amateurs, des pions qui se croient les maîtres du damier."
Bonne lecture !
Richard, Polar Noir et blanc
La nuit des Albinos
Mario Bolduc
Expression Noire
2012
414 pages
La page de l’auteur sur le site de Libre Expression
03/12/2012 | Lien permanent | Commentaires (1)
La disparition soudaine des ouvrières, de Serge Quadruppani (chronique 3)
 Une chronique d'oncle Paul.
Une chronique d'oncle Paul.
Peut-être avez-vous constaté comme moi que cette année, guère d’abeilles batifolent sur les fleurs. A cause du temps maussade ? A cause de fleurs en retard dans la floraison ? A cause d’un dérèglement de leur métabolisme ? A cause d’une raison inexpliquée ? Toutes les hypothèses peuvent être envisagées, même les pires.
Dans un couple, il faut toujours que l’un cède devant les caprices de l’autre, sous peine de conflits et de dissolution. La commissaire antimafia Simona Tavianello, qui préfère passer ses vacances au bord de la mer, plus précisément à Salina l’une des îles Eoliennes près de la Sicile, a accepté, pour une fois, de se plier selon aux désirs de son mari, le questeur (une sorte de commissaire principal) en retraite Marco Tavianello. Mais au lieu de se balader dans cette vallée du Piémont où ils résident, elle a imposé son envie d’aller acheter du miel chez l’apiculteur Giovanni Minoncelli. Seulement on poussant la porte du bâtiment, ils se trouvent confrontés à un cadavre gisant à terre.
L’adjudant de carabiniers Calabonda, surnommé Cacabonda à cause d’un journaliste ou d’un de ses hommes qui a mal compris l’énoncé de son nom ainsi qu’aux quelques boulettes qui entachent sa carrière, prend la direction des opérations. Près du corps une feuille blanche a été déposée avec inscrits au feutre ces quelques mots : Révolution des Abeilles. Pas grand-chose à se mettre sous la main sauf que, quelques heures plus tard, Caca… pardon Calabonda se met en contact avec Simona et Marco, qui discutent de l’affaire à une terrasse de café, pour leur demander comment il se fait que la balle tirée dans la tête du défunt provient de l’arme de service de la commissaire antimafia. Son arme de service qu’elle avait emmenée avec elle sur l’injonction de ses supérieurs. A la même terrasse, Giuseppe Felice, journaliste local, se demande comment aborder les deux vacanciers. Mais une timidité rédhibitoire le cloue sur sa chaise.
La victime n’est autre que l’ingénieur Bertolazzi, lequel était chargé pour le compte de la société Sacropiano de la commercialisation des produits de la firme, c'est-à-dire de semences OGM et de pesticides. Et bien évidemment il était la cible privilégiée de la colère des apiculteurs de la région. Depuis quelque temps les hyménoptères sont sujets au syndrome d’effondrement des colonies d’abeilles domestiques. Elles partent sans crier gare et on ne les retrouve jamais. Pas de cadavres, ni dans la ruche, ni à proximité. Un phénomène inquiétant. Aussi penser que Minoncelli serait l’auteur du meurtre est présent à l’esprit de Calabonda, sauf qu’au moment du drame celui-ci était justement dans la propriété de Bertolazzi en train de manifester et de déployer des bannières en compagnie d’autres membres du collectif de protection des abeilles.
Une autre piste est envisagée car Bertolazzi était un homosexuel, ce qui en soi n’est pas problématique, mais il avait une vie sexuelle assez dense et pour l’heure son amant était un berger Albanais vivant non loin. Bien malgré elle Simona Tavianello est impliquée dans cette ruche bourdonnante Un autre homicide est enregistré près des ruches de Monticelli. Particularité de la victime : sa tête est à moitié défigurée par une attaque d’abeilles, l’autre a été emportée par une balle de gros calibre.
Ciuffani, un journaliste bien connu de Simona pour être proche du pouvoir, deux frères, l’un responsable de la Sacropiano et l’autre patron du journal local, s’invitent dans cet essaim déjà constitué de journalistes, de carabiniers, d’apiculteurs en colère et autres.
Serge Quadruppani se montre aussi pointilleux dans l’écriture de ses romans que dans ses traductions, notamment celles des romans d’Andrea Camilleri. Il ne se contente pas de narrer une histoire mais apporte de nombreux éléments afin d’affiner son propos. La disparition des ouvrières, des abeilles, est un problème de société dont pâtissent les apiculteurs. Et derrière cette profession, c’est tout un système voué aux produits chimiques qui est mis en cause. Mais la politique s’invite également dans cette histoire qui ne pouvait ignorer les remous du parti au pouvoir, la concussion, mais aussi Le Ligue du Nord.
Serge Quadruppani nous offre une autre vision du monde actuel, plus proche de la nature, pointant du doigt les dérives des laboratoires chimiques et de la finance. Evidemment, la vie des abeilles, ou plutôt la mort touche peu de monde, pour l’instant, mais si ceci n’est qu’un microcosme, cette brèche ouverte peut s’étendre de façon sournoise à tout un système écologique préjudiciable à l’être humain.
Paul (Les lectures de l'oncle Paul)
La chronique d’Albertine sur ce roman.
La chronique de Paco sur ce roman.
A lire aussi, la chronique de Paul sur : Saturne.
La disparition soudaine des ouvrières.
Serge QUADRUPPANI
Moyen format. Le Masque (Septembre-2011).
224 pages. 17€.
29/06/2012 | Lien permanent
Les Péchés de nos pères, de Lewis Shiner
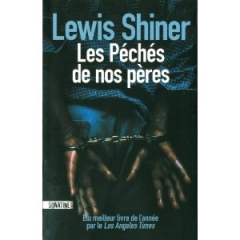 Une chronique de Bruno
Une chronique de Bruno
Voilà un roman qui m’aura permis de terminer l’année 2011 sur une lecture particulièrement passionnante. L’auteur ne vous dira sans doute pas grand-chose, sauf à être un lecteur de Science Fiction, car Lewis Shiner est d’abord un écrivain de ce genre littéraire. Mais son incursion dans le roman noir est plutôt une réussite, et pour une première, c’est une agréable surprise.
Ancien ouvrier du bâtiment, ancien dessinateur de BD, musicien et donc écrivain, on retrouve dans son roman « Les péchés de nos pères » certains des ingrédients qui ont fondé sa propre existence.
Ce livre est donc son premier roman noir. Et noir, il l’est profondément puisqu’il plonge le lecteur dans les affres d’une des pages les plus sombres de l’histoire américaine, celle de la ségrégation raciale et de la soumission des noirs américains à la suprématie blanche.
Le père de Michaël se meurt, rongé par un cancer qui chaque jour l’éteint un peu plus. Cela fait des années qu’il n’est pas revenu dans cette ville de Durham qui l’a vu grandir et où sa famille a toujours vécu. Travaillant dans la bande dessinée, il est parti construire sa réussite et bâtir sa vie bien loin de cette ville où plongent ses racines familiales.
Michaël revient donc près de son père avec qui il a tant de mal à communiquer. Mais les derniers souffles de la vie d’un homme peuvent parfois soulever des poussières sombres, accumulées sur les souvenirs d’une existence et mettre à jours des choses qu’on aurait souhaitées qu’elles ne remontent jamais à la surface.
Dès son arrivé l’atmosphère est pesante. Michaël devine que son père à des choses à lui dire, qu’un secret l’empêche de partir en paix. Mais celui-ci reste malgré tout fermé ou évasif. Alors Michael va chercher, près des siens, de ses parents qu’il n’a pas revus depuis des siècles, des anciens collègues de son père, à attraper ce fil de l’histoire qui lui échappe.
Comme quelqu’un qui buterait sur une racine qui effleurerait le sol, Michaël va finalement trébucher sur les siennes en apprenant qu’il n’est pas né l’année où il est censé l’avoir été. En les mettant progressivement à jour, il découvrira des secrets vieux de plusieurs décennies, qui l’emprisonneront dans la toile d’une histoire qui le dépassera, et dont pourtant il portera la trace dans sa chair et dans son âme.
Mais à remonter le cours de ses origines familiales, Michaël devra emprunter bien des méandres. Car ce jeu de piste tortueux va le conduire à un cadavre, enseveli dans les replis de l’histoire de cette cité noire à la pointe de la lutte pour les droits civiques dans l’Amérique de l’après guerre. Ce cadavre c’est celui de Barret Howard, un activiste noir de l’époque, dont on avait fini par croire qu’il était soudainement parti pour le Mexique. Et Michaël de déchirer ce voile de silence qui enserrait la mémoire de son père dans un carcan de culpabilité venimeuse.
La mise à nue de la vérité va alors porter un éclairage cru sur l’histoire familiale qui s’inscrit au burin dans celle de ce quartier de Durham, Hayti, et qui embrasse celle de cette époque marquée de soumission et de luttes émancipatrices.
Lewis Shiner nous livre une fresque qui court sur près d’une quarantaine d’années. Le lecteur suit des tranches de vie des différents personnages.
De Michaël bien sûr, qui à partir de la recherche d’un secret va finalement se lancer dans la quête de sa propre identité. De son père Robert de 1960 à 1970, jeune architecte prometteur, qui côté blanc, face émergée, se consacre à la conception de cette autoroute qui va dévaster le cœur de Durham, et côté noir, face cachée, qui se passionne pour la musique afro-américaine, découvre le vaudou, et se délivre dans un abandon de soi et une ivresse des sens. De sa mère Ruth enfin, issue d’une famille aisée, dont le père, un des plus gros notables de la région, dirige d’une main de fer ses affaires et orchestre la vie des siens.
Shiner arrive chaque fois à plonger son lecteur dans l’ambiance de l’époque. Truffée d’anecdotes, de petites scènes qui s’agrègent à la trame générale de l’histoire, il finit par dépeindre la réalité de cette société d’après guerre, violente, raciste et discriminatoire, shooté au développement économique. Une société où une seule goutte de sang africain dans les veines fait de vous un noir, alors qu’une goutte de sang européen ne fait pas de vous un blanc.
Mais sa véritable force, c’est de montrer que la haine se transmet comme un bien de famille, que ce que la société dominante lâche d’une main, elle le reprend d’une autre. Quand elle reflux comme une marée en laissant enfin accessible des droits civiques aux noirs, elle revient plus forte sur la vague du développement économique en emportant tout sur son passage, à l’image de cette autoroute qui dévaste et met à mort le quartier d’Hayti, où de ces multinationales qui vampirisent des terrains où s’entassent les plus pauvres, pour assurer leur propre expansion.
Ce roman est aussi une ode à la culture noire, de ces hommes soumis, enfin debouts et rebelles, qui ont su faire naitre dans leurs chants et de leurs danses la petite flamme de l’espoir et de la liberté. Un roman d’où émane une certaine forme de mélancolie, non pas de cette époque révolue dans ce qu’elle avait de plus honteux, mais de cette contre culture comme un rempart au désespoir.
Enfin, c’est aussi une magnifique histoire d’amour, une pièce du puzzle dont Michaël ressentait l’absence, la clé dont il avait besoin pour ouvrir la porte de son passé. Un passé, qui oblige les enfants à assumer les péchés de leurs pères.
Bel exercice que ce premier roman noir qui mêle, ségrégationnisme, lutte pour les droits civiques, meurtre, groupes d’activistes, amour, musique et violence sociale.
Gageons que l’auteur renouvelle l’expérience, car il a visiblement toute sa place dans le roman noir !
Le blog de Bruno : http://passion-polar.over-blog.com/
Les Péchés de nos pères
Lewis Shiner
Sonatine, novembre 2011
598 pages, 22 €
21/01/2012 | Lien permanent


