11/02/2012
Soie, d'Alessandro Baricco
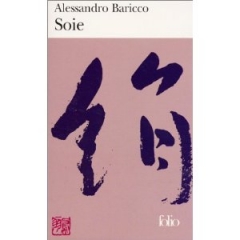 Une chronique de Jacques.
Une chronique de Jacques.
La perfection est atteinte « non quand il n'y a plus rien à ajouter mais quand il n'y a plus rien à retrancher », nous dit Saint-Exupéry dans Terre des homme.
Le livre d’Alessandro Barricano est l’illustration parfaite de cette remarque. Loin des romans trop bavards, des histoires qui se perdent dans des détails futiles ou des digressions pesantes, ce roman très court –de la taille d’une longue nouvelle – est un petit bijou littéraire limpide et fluide, d’une richesse thématique qui va inciter le lecteur à créer son propre univers, sa propre lecture, le récit servant de piste de décollage à son imagination.
Le premier thème qui m’a frappé dans ce récit est celui du mystère. Et tout d’abord celui des êtres que rencontre Joncour, qu’il ne comprendra jamais totalement : Hélène, Baldabiou, Hara Kei, et bien sûr la femme sans nom ô combien mystérieuse, qui le fascine et qu’il aime, pense-t-il. Mais Joncour lui-même est aussi une source de mystère pour le lecteur. L’essentiel de ses sentiments nous restera caché, et nous le verrons agir sans savoir ce qu’il pense : il nous reste opaque, étranger.
Pour montrer cette opacité, Baricco utilise ici les techniques du roman comportementaliste, pour lequel l’introspection est bannie, où les personnage sont saisis à travers leurs actes, leurs comportements face aux différentes situations qu’ils rencontrent. La psychologie est induite par les actes, jamais décrite. Lorsqu’Hélène meurt, nous ne saurons pas ce qu’il ressent. Nous saurons simplement « qu’il fit graver sur sa tombe un seul mot. Hélas. » Cette sobriété et cette extériorité permettent des interprétations multiples et ajoutent encore à la richesse de la lecture.
Le deuxième thème est lié au premier : la double histoire d’amour que raconte Baricco est placée sous le signe de l’incompréhension de l’Autre. Certains diraient : l’incommunicabilité, si ça ne faisait pas aujourd’hui un peu trop tarte à la crème.
Joncour aime deux femmes et semble être aimé des deux. Il aime la femme sans nom rencontrée au Japon, et il aime sa femme Hélène. Il les aime et ne comprend aucune des deux. Cette femme sans nom, comment pourrait-il la comprendre ? Ils ne parlent pas la même langue, et quand il croit avoir enfin déchiffré ce qu’elle pourrait lui dire, il découvre bien plus tard que c’est une autre qui lui a parlé.
Mais il ne comprend pas mieux sa femme Hélène, découvrant après sa mort son geste étonnant . Que cherchait-elle en lui écrivant une lettre d’amour que Joncour pensait écrite par la femme sans nom ? Etait-ce un moyen habile pour elle de le pousser à se déprendre de sa rivale ? De permettre à Joncour, en vivant ses fantasmes jusqu’au bout, d’oublier enfin cet amour impossible ? Etait-ce une preuve d’amour unique d’une femme prête à se sacrifier pour que l’homme qu’elle aime soit heureux ? Nous n’en saurons rien. Le mystère subsistera jusqu’au bout, renforcé par le comportement d’Hélène au moment du départ de Baldabiou : « Alors Hélène fit une drôle de chose. Elle s’écarta d’Hervé Joncour, et elle courut après Baldabiou pour le rattraper, et elle le serra dans ses bras, fort et tout en le serrant éclata en larmes. Elle ne pleurait jamais, Hélène. »
Au fond, que savons-nous des vrais sentiments d’Hélène ? De ses rapports réels avec Baldabiou quand son mari s’absente pendant de longs mois au Japon ?
Là encore, le récit prend ici le contrepied des banalités dont nous sommes assommés tous les jours. Pour dissiper les malentendus, nous devons parler, discuter, parler encore, parler toujours, nous explique-t-on partout. Or ce roman est le roman du silence et du non-dit. Puisque l’Autre est irréductiblement mystérieux, pourquoi espérer dissiper le mystère par une parole vaine ?
Le récit des voyages de Joncour au Japon se résume à quelques phrases chaque fois répétées à l’identique et qui énumèrent les villes et les frontières traversées. « il passa la frontière près de Metz, traversa le Wurtemberg et la Bavière, (…) parcourut à cheval deux mille kilomètres de stepper russe, (…)redescendit le cours du fleuve Amour, longeant la frontière chinoise jusqu’à l’Océan (…) ».
Ce faisant, Barrico prend le contrepied d’une affirmation qui est devenu aujourd’hui un truisme : dans le voyage, ce n’est pas la destination qui compte, c’est la route. Sans doute ce truisme comporte-t-il sa part de vérité, mais le Japon est pour Joncour la métaphore, concentrée en un point unique, des objectifs dérisoires, ordinaires ou grandioses que chaque homme peut fixer à sa propre vie. Ces objectifs, il peut ou non les atteindre, mais ce sont eux qui le forgent et le forment, qui font de lui un humain inscrit dans son époque.
Le but de Joncour peut sembler dérisoire, puisqu’il s’agit pour lui de trouver des œufs minuscules qui vont donner un jour une soie certes somptueuse, mais si délicate et ténue que lorsqu’ on la serre dans son poing, on a l’impression de ne rien tenir entre les doigts. Une matière presqu’inexistante, mais capable de donner un plaisir esthétique évanescent et fugace. Aussi évanescent et fugace que la vie d’un être humain.
En filigrane, Alessandro Baricco développe ainsi une réflexion qui pourrait être résumée ainsi : qu’est-ce qu’une vie d’homme ?
Au début du récit, deux phrases présentent Hervé Joncour au lecteur : « C’était au reste un de ces hommes qui aiment assister à leur propre vie, considérant comme déplacée toute ambition de la vivre. On aura remarqué que ceux-là contemplent leur destin à la façon dont la plupart des autres contemplent une journée de pluie. »
Cette contemplation de sa propre vie donne au personnage de Joncour légèreté et profondeur.
Légèreté dans son rapport au monde, simple, direct, sans arrière pensée, détaché des contingences matérielles.
Profondeur liée à la part de mystère qui va rester attachée à lui par la grâce de l’auteur. Sa vie d’adulte va se dérouler devant nous, réduite au dévoilement de quelques évènements qui pour certains d’entre eux semblent avoir été choisis de façon arbitraire, pour d’autres restent marqués du sceau d’une répétition tranquille et monotone. A plusieurs endroits du récit, des phrases entières sont répétées mot pour mot, et cette répétition lancinante traduit le côté dérisoire et futile de sa vie.
Mais sa vie n’est pas que cela : comme le dit Barrico à la fin du roman, elle est aussi l’expression d’une liturgie d’habitudes qui nous défend du malheur, un cocon (de soie ?) dans lequel nous pouvons nous envelopper et nous protéger. Joncour est le spectateur distancié de sa propre vie, tout comme le lecteur est le spectateur de la vie de Joncour.
Spectateur extérieur, ô combien ! Car nous ne saurons presque rien de ses joies, de ses souffrances, de ses sentiments. Après la mort de sa femme, il passe des heures à regarder les rides de l’eau sur le lac « parce qu’il lui semblait voir, dessiné sur l’eau, le spectacle léger, et inexplicable, qu’avait été sa vie ».
Notre vie d’homme est une simple et fugace ride sur l’eau d’un lac, nous dit Alessandro Barrico, et même si vous vivez, comme le fait Joncour, une vie aventureuse, la ride sur l’eau du lac sera tout aussi vite effacée.
Quatrième de couverture
Vers 1860, pour sauver les élevages de vers à soie contaminés par une épidémie, Hervé Joncour entreprend quatre expéditions au Japon pour acheter des neufs sains. Entre les monts du Vivarais et le japon, c'est le choc de deux mondes, une histoire d'amour et de guerre, une alchimie merveilleuse qui tisse le roman de fils impalpables. Des voyages longs et dangereux, des amours impossibles qui se poursuivent sans jamais avoir commencé, des personnages de désirs et de passions, le velours d'une voix, la sacralisation d'un tissu magnifique et sensuel, et la lenteur, la lenteur des saisons et du temps immuable. Soie, publié en Italie en 1996 et en France en 1997, est devenu en quelques mois un roman culte - succès mérité pour le plus raffiné des jeunes écrivains italiens.
07:08 Publié dans 06. Il y a une vie hors du polar ! | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook | |
Facebook | |


